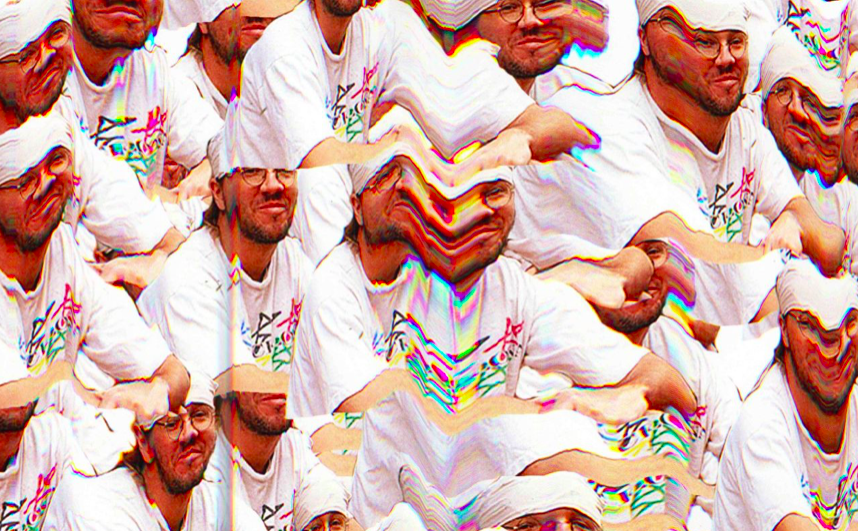Wallace ou gros mythe ?
(derrière ce titre putatif, plus qu'une critique de L'infinie comédie, quelques mots sur David Foster Wallace)
Si en 2008 disparaissait DFW avant qu'il n'eut achevé la rédaction de son troisième roman (Le Roi Pâle), c'est que l'homme avait fini par être emporté par les affres de ce qui le tourmentait lors de sa première tentative de suicide en 1989 (je passe volontairement les détails biographiques car ce n'est pas le sujet, pour tout renseignement complémentaire, lire Même si, en fin de compte, on devient évidemment soi-même de David Lipsky ou la Biographie de D.T. Max — dont vous trouverez la critique ci-dessous d’ailleurs).
Wallace, en plus d'avoir été un génie littéraire, un auteur terriblement sympathique et attachant, un professeur humble et humain, était un esprit lucide, perfectionniste et dépressif. Si ces trois derniers traits auront raison de lui après une lutte incommensurable pendant plus de vingt ans, ils auront, malgré eux, contribué à produire quelques unes des meilleurs pages de ce caractère si touchant, propre à David.
Son œuvre, qui n'est pas sans rappeler les délires et la passion pour les narcoleptiques de Pynchon, a toujours évolué autour de sujets américains en proie au doute, aux difficultés d'être soi, et aux barrières psychosociologiques dressées par l'individu en mal de communication avec ses semblables. Destins et personnages brisés, la littérature de Wallace tend à prouver encore et toujours que « (…) nous luttons ainsi, barques à contre-courant, refoulés sans fin vers notre passé » pour citer la fin de Gatsby. Son monde est chaotique, à l'image de celui que peint la littérature post-moderne, sa société de consommation défonce ses habitants et l'homme se retrouve nu, seul, déviant, avec pour seul miroir pour se divertir de sa condition misérable (littéralement se détourner de) un écran trouble et manipulé, pareil à la fenêtre qu'il n'ouvre plus sur le monde, mais qui trompe sa perception de la réalité par ses images fabriquées.
L'infinie comédie voit le jour en 1996 dans une liesse sans pareil pour un auteur de cette trempe, après la publication saluée dans le magazine Harper's de son essai Un truc soit-disant super auquel on ne me reprendra pas (publié dans le recueil éponyme) qui contribua à ce succès retentissant. Fruit de trois années d'écriture, deux de relecture et modifications de cette somme de pages (le produit final pèse tout de même ses 1480 pages), la carrière de Wallace s'envole littéralement après son adoubement par Esquire en 1987 alors qu'il publiait son premier roman (La Fonction du Balai) à 24 ans, et le désignait comme jeune espoir de la littérature américaine en faisant par là-même naître cet inextricable malaise qui le poursuivra toute sa vie. Car Wallace est un perfectionniste, il ne veut de lui que le meilleur et cette exigence de qualité envers lui-même, cette attente croissante d'une nouvelle production le promèneront dans le doute le plus total. Cependant, après des années de travail acharné, d'étude sur le terrain, de lectures consacrées, trois déménagements, David semble de nouveau confiant quant à son écriture, s'ensevelit sous les pages rédigées et loin de s'attendre à un tel succès, entraperçoit la qualité de sa production : vient enfin, en manière de justice, la consécration.
Dans la forme, Infinite Jest assoit le style pur de Wallace :
-- Les acronymes et les abréviations prolifèrent (que ce soit pour des personnages, des noms d'entreprises ou des des fonctions), Wallace sait que son siècle va de plus en plus vite et que sous couvert de rapidité pratique se cache un obscurantisme du sens des abréviations qui cherche à perdre les personnages et ses lecteurs (poussé au paroxysme dans Le Roi Pâle).
— Le récit pullule de marques citées, non seulement pour ancrer le récit dans un réel (bien qu'il soit placé dans le futur, comme une anticipation) mais comme références évidentes à cette société de consommation qui a prit le pas sur les références historiques et culturelles chez les personnages. Plus encore et avec force symbolique : dans la trame narrative, ce sont les années qui sont disputées et prennent le nom des sociétés les plus offrantes.
— David aime montrer sa connaissance des sujets et sa maîtrise du langage scientifique et universitaire en construisant des passages extrêmement pointus et ardus dans les thèmes des mathématiques (qui lui sont chères, voir son essai : Tout et plus encore) et la pharmacologie et biochimie. S'il se montre parfois pédant ou méprisant envers son lecteur, il faut comprendre que ces démonstrations sont là également pour être absconses.
— C'est dans L'infinie comédie également que l'on voit apparaître la profusion démentielle de notes (au nombre de 380 tout de même), qui si elles viennent rarement expliquer le sous-texte du récit, souvent développent des pans entiers de la trame (certaines notes font plus de vingt pages et qui sont pour la plupart des passages que voulait supprimer l'éditeur). Malgré leur position en fin de livre qui ne rend pas leur lecture obligatoire (chose qu'il corrigera dans sa mise en page par la suite), l'œuvre perd grandement de son intérêt à celui qui les omet.
— Enfin, le post-modernisme tant apprécié par Wallace pour sa retranscription volontairement chaotique du monde et ses références populaires, fait se développer la trame via différents narrateurs qui donneront à L'infinie comédie toute sa moelle et sa substance.
Car dans le fond, le tour de force de DFW, ce n'est pas juste la maitrise virtuose de quelques techniques qui combleront un lecteur exigeant d'une centaine de pages d'un de ses essais, mais qui ne justifieront certainement pas une œuvre de cette envergure : L'Infinie Comédie a un propos dense. Les différents narrateurs, aux trajectoires, conditions et caractéristiques propres, viennent étoffer un récit qui se développe lentement autour d'une poursuite d'un bonheur désillusionné. Que ce soit Hal le jeune tennisman accro à la weed (et sans doute le personnage le plus proche de DFW adolescent), Gately l'ex junkie devenu accro aux réunions des Alcooliques Anonymes, Marathe l’indépendantiste handicapé qui trahit son clan pour sauver une existence vouée à la mort, Orin le frère ainé de Hal, consommateur d'amitiés-longues-mais-seulement-pour-une-nuit avec des sujets féminins ou encore leur père, James Incandanza, cinéaste aux tentatives filmiques avant-gardistes, comblant par ses créations son incapacité à communiquer avec sa progéniture : la galerie de personnage de Wallace s'étoffe avec des portraits touffus et variés, hauts en couleur et souvent broyés par l'amère réalité.
Mais le véritable cœur de l'œuvre, à l'instar de l'objet qui fait la quête d'une partie de ses personnages, est bel et bien le divertissement. Qu'il soit sous forme d'alcool, de drogue ou de médicament de substitution (et DFW sait de quoi il parle), sous la forme du sexe, du sport ou de la pratique d'un art (le cinéma ici), le divertissement renvoie irrémédiablement vers cette froideur de la société américaine de consommation qui met nombre de ces personnages au rebut. Le divertissement soulage les protagonistes, les détourne de leur propre situation problématique puis les plonge dans un mal encore plus profond. C'est là un portrait au vitriol que fait Wallace d'une Amérique capitaliste et impérialiste avec ses habitants succombant aux maux qu'elle-même engendre. La deuxième partie de cette critique émise par l'auteur concerne directement la télévision (vers laquelle chaque foyer américain se tourne en moyenne six heures par jour). La mise en place du système de télédiffusion d'InterLace (qui n'est pas sans m'évoquer un futur Netflix) supplantant le divertissement audiovisuel tel qu'on le connaissait en triant à la source les programmes distribués et produisant ceux qui devront l'être. La télévision de L'infinie comédie – comme ce qui se fait déjà depuis longtemps – tend un miroir fantasmé à ses spectateurs d'un monde où la richesse et le succès riment avec l'épanouissement de l'individu et font le jeu de la condition à cet accès : la consommation via la publicité.
Face à cela, les personnages suivis développent une certaine foi, qui si elle n'est pas exclusivement religieuse, respecte un ensemble de valeurs (voir C'est de l'eau), dressé par l'individu confronté à cette brutalité du monde, et bien que tous n'y parviennent pas, que la note de fin laissée par cet immense roman foutraque ne soit pas positive ou heureuse, je pense qu'il faut malgré tout retenir ces personnages face à leur condition dénuée de plaisir et leur difficulté d'exister comme des lutteurs acharnés, ainsi que l'a été l'auteur.
La sympathie que DFW développe envers ses personnages le montre bien, il n'y a ni révolte ni résolution. Des traits de lui sont reconnaissables en chacun et sa connaissance aigue de la nature humaine qu'il n'a cessée d'observer, en commençant par lui-même et ses complexes, de ses rapports dont il a toujours essayé si ce n'est d'imaginer les rouages, de décrypter et de comprendre ses dessous, éclaire le texte par sa compréhension, son extra-lucidité, sur ce qu'est l'existence de l'humain à notre siècle. De là, il tire parfois tout le sel et l'ironie qui acidulent ses récits loufoques et grotesques.
Ce qu'il faut retenir de L'infinie comédie, c'est que c'est une œuvre totale. Tour à tour hilarante et délirante, horrible et réjouissante, complexe et subtile, morbide et complète, elle est dans le fond magistralement humaine cette Comédie. On y entre comme dans l'esprit de l'auteur torturé, on en ressort bouleversé notamment par ces passages d'une justesse prodigieuse sur la dépression et le mal-être. L'infinie comédie n'est pas une œuvre sans espoir ou désespérée, c'est le récit et l'histoire de l'existence en lutte dont l'œuvre, parfois, finit par avoir raison de son auteur.
— juillet 2017
Un nouveau shérif à Fiction City, USA
Loin de moi l'idée de remettre en cause la sincérité (faute de légitimité) de l'entreprise ardue dans laquelle s'est lancé D.T. Max, seulement, la parution en 2012 de la première biographie consacrée à DFW me pose tout un tas de questions à l'heure glaçante du post-décès de l'auteur pendant laquelle se multiplient naturellement, tels les pains, une chiée de bouquins plus ou moins recevables et rééditions savamment markétées.
Alors que les écrits universitaires s'intéressaient sérieusement à sa production, que les attentes augmentaient exponentiellement quant à son prochain grand roman (Le Roi Pâle, inachevé), David Foster Wallace se donnait la mort en septembre 2008, après avoir connu une vie médiatique, intérieure et personnelle des plus complexes. Le travail du présent ouvrage, son auteur n'ayant pas connu personnellement Wallace (et ce n'est pas là une sorte de reproche car bien d'excellentes biographies ont vu le jour sans cette spécificité, qui peut donner plus de cachet, de légitimité à l'ensemble ou bien à l'inverse biaiser complètement le résultat), le travail produit en amont dis-je, je le reconnais, a été colossal et l'auteur ne s'épanche pas sans raison de cinq pages de remerciements en fin d'ouvrage sur les proches et correspondants de Wallace qui ont apporté leur pierre à l'édifice (ce qui lui donne une certaine reconnaissance en la matière également, on peut le noter). Cependant, à la lecture de ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher de me questionner :
– Est-ce qu'une biographie était absolument nécessaire à Wallace et éclaire d'une nouvelle manière son œuvre ?
– Plus généralement, quels aspects de l'auteur se doit de traiter le biographe ?
– Comment les présente-t-il et comment fait-il intervenir ses sources ?
A la première question, ayant lu avidement l'œuvre traduite de Wallace (excepté son ouvrage théorique de vulgarisation sur les mathématiques, l'infini et son concept philosophique logique Tout et plus encore, une brève histoire de l'Infini), la lecture récente d'une nouvelle intitulée Ce cher vieux néon, présente dans le recueil L'oubli, a légèrement modifié ma perception et compréhension de Wallace et mis en avant un de ses traits qui me paraissait mineur ou négligeable dans sa personnalité d'homme :
« Selon le paradoxe de l'imposteur, plus on met de temps et d'efforts à essayer de paraître impressionnant ou séduisant aux yeux des autres, moins on se sent impressionnant ou séduisant au fond de soi – on est un imposteur. Et plus on se sent imposteur, plus on essaie de projeter une image impressionnante et agréable pour éviter que les autres ne découvrent qu'on est en réalité une personne creuse, un imposteur. »
p180, Ce cher vieux néon in L'oubli
En suivant chronologiquement l'établissement de cet homme dans sa vie du Midwest étasunien, D.T. Max s'attarde bien sûr malencontreusement sur des détails insignifiants et futiles (parce qu'ils sont des souvenirs, anecdotes, citations qui étoffent la connaissance théorique qu'il peut avoir de son « personnage », et ce tout au long de la biographie), mais par fragment, arrive à dépeindre assez finement des aspects psychologiques de ce qui (me) semble avoir été le véritable DFW : un jeune auteur prodigieusement intelligent, avide de prouver sa véritable valeur et l'étendue de ses talents et connaissances, mais à la fois très tourmenté par le succès qui vient le célébrer dès son premier roman alors qu'il n'a que 23 ans, et souffrant surtout d'une crise existentielle profonde. Plus les années passent et plus Wallace est convaincu qu'il serait un homme pour qui ce savoir n'est qu'une façade creuse derrière laquelle il cacherait son vide intérieur, sa pauvreté, son incroyance pour autre chose que des règles empiriques et logiques, c'est un homme angoissé, extra-lucide, qui cherche désespérément à croire, si ce n'est en lui-même et sa véritable valeur, en une existence en accord avec soi-même, loin de cette quête folle de certitude.
A ce titre, le « diagnostic » de Max semble assez recevable et appuyé par les témoignages de ses proches lors des différentes crises que Wallace a traversées. Bien que l'œuvre de DFW abonde d'exemples de ce mal-être, de cette compréhension extrêmement sensible du caractère dépressif, la biographie permet en certains points de mettre en relation ces épisodes douloureux de doute avec ce qu'ils ont permis de produire chez l'auteur disparu.
Si la biographie se perd parfois comme je le disais dans des souvenirs futiles pendant quelques paragraphes, je me dois également de remarquer que le nombre de notes (peut-être un emprunt stylistique à DFW d'ailleurs, lui-même en ayant usé et abusé dans ses écrits) justifie rarement leur qualité. Parfois glissées inopinément, elles sont souvent sans rapport direct avec le contenu présent de la lecture et ne font que rapporter un commentaire d'une des sources, de sorte que l'ensemble donne l'impression d'avoir subi un mauvais écrémage. Ces sources avec lesquelles il correspondait beaucoup (sa sœur Amy, ses amis, collègues, auteurs contemporains Franzen ou DeLillo par exemple), j'aurais aimé, à l'instar des profondes réflexions que se posent DFW sur ce que doit être la littérature de nos jours, à ce qu'elles ne soient pas sans cesse présentées comme « au bon de souvenir de » donnant ainsi un aspect très artificiel, amateur et répétitif à la narration omnisciente d'une vie, celle d'un journaliste renseigné mais incapable de se départir de son style.
C'est pourtant lorsqu'il rend compte des derniers événements et plus spécialement qu'il évoque l'œuvre de Wallace que D.T. Max semble le plus à l'aise. Mettant à concours des spécialistes de son œuvre et sa propre lecture, il évoque en quelques paragraphes synthétiques et analytiques très justes chaque ouvrage paru de Wallace et notamment ses écrits qui nous dévoilent ses aspects les plus profonds et cachés.
« Sous le nouveau gouvernement du fun, écrire de la fiction devient une façon de s'aventurer profondément en soi-même et de mettre au jour tous les trucs qu'on voudrait justement cacher à soi-même comme aux autres, et ces trucs se révèlent (paradoxalement) être précisément ce que tous les écrivains, tous les lecteurs, partagent, ce qui les fait réagir, vibrer. La fiction devient une étrange manière de s'affirmer et de dire la vérité, au lieu d'un moyen de s'échapper à soi-même ou de se présenter sous un jour où on se croit d'une amabilité maximale. »
p232, extrait d'un article de DFW pour Conjunctions en 1993
Derrière cette biographie nécessairement imparfaite pourtant, l'amoureux que je suis de Wallace a pourtant su voir esquissé, un portrait qui, s'il manque de l'authenticité dont pourrait se faire valoir un de ceux de Franzen ou Mark Costello (deux auteurs très proches de lui), trouve assez de recul et d'objectivité (bien que Max ne cache pas son admiration pour lui – et comment faire autrement quand on entreprend une biographie d'un tel personnage) pour peindre un homme presque sensible, tangible, dans ses dernières pages. Plus que dans l'ouvrage du journaliste David Lipsky consacré à ses entretiens pendant lesquels il a suivi Wallace durant plusieurs jours (Même si, en fin de compte, on devient évidemment soi-même, 2010, dont beaucoup d'anecdotes sont réutilisées ici), D.T. Max nous livre un Wallace poignant et torturé comme je ne doute pas un seul instant qu'il a été.
En bout de course, je vous dirais que c'est un ouvrage que je ne recommande qu'uniquement aux amoureux voyeurs et insatiables de DFW, qui malgré ses faiblesses de style et d'élaboration, fait preuve d'une solide documentation ainsi que d'une justesse non négligeable. Je vous laisse sur cet extrait d'une lettre de David à un autre David (Markson, auteur qu'il admirait passionnément notamment pour son roman La maîtresse de Wittgenstein - philosophe et linguiste qui était leur passion commune), c'était en 1996 après la parution et le succès de L'infinie comédie :
« J'essaie de me souvenir que je suis bien chanceux de pouvoir écrire, et deux, trois fois plus chanceux encore qu'on veuille bien me lire, sans même parler de me publier. Je n'ai rien d'un optimiste béat – garder le moral, toutes ces conneries, c'est du boulot, et souvent je n'y arrive pas si bien que ça moi-même... Mais je m'y efforce. La vie est belle. »
p297
Et menant cet éternel combat, le nouveau shérif arrivé à Fiction City s'en était pourtant allé.
— novembre 2017